L’histoire d’un créateur, d’une idée, d’une marque.
L’histoire d’un voyage, d’un équipage, d’un héritage.
Pascal Galinier
Journaliste aux Échos, au Nouvel Économiste, au Monde, j’ai enquêté des années durant sur nombre d’histoires d’entreprises et d’entrepreneurs, de marchés et de produits, d’idées folles et de paris réussis.
J’ai raconté ces aventures auxquelles pas grand monde ne croyait à leurs débuts. Et qui ont enfanté des leaders, des modèles, des icônes parfois.
J’ai aussi écrit des livres sur les coulisses de la mondialisation, la montée en puissance du soft power des marques
Pourquoi un livre d’entreprise
Quoi de mieux qu’un livre pour mesurer le chemin parcouru, depuis la.création de votre entreprise jusqu’à aujourd’hui et surtout à demain, qui est « moins à découvrir qu’à inventer », comme disait Gaston Berger.
Un livre est un outil décisif pour développer la culture de l’entreprise, son image, la motivation de ses salariés, renforcer les liens avec les clients, les partenaires, les fournisseurs. Et préparer l’avenir.
Coca-Pepsi, le conflit d’un siècle entre deux world companies
Ecrit en mode mi-polar mi-storytelling pour la collection Les Guerriers de l’Économie (éditions Assouline), ce livre raconte la « guerre de cent ans » que se livrent les deux géants du soft drink. En toile de fond, l’irrésistible montée en puissance des Etats-Unis, la mondialisation, le soft power des multinationales
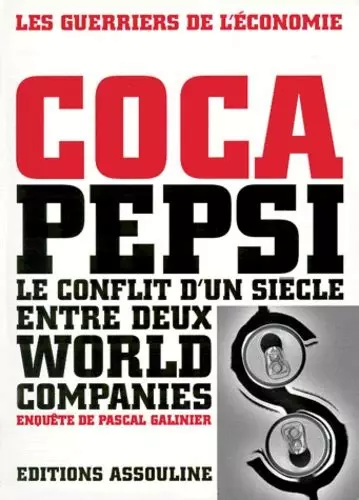
Depuis un siècle, les deux géants du soft drink se livrent un combat sans merci à l’échelle planétaire.
« Quand l’un choisit le rouge, l’autre choisit le bleu. Quand Coca-Cola sponsorise le Mondial de foot et les Jeux Olympiques, Pepsico investit le showbiz avec Michael Jackson et s’envole dans l’espace avec la NASA. Quand Coca décide de s’implanter au Venezuela, il vire Pepsi manu militari en un week-end. Quand Pepsi veut empêcher Coca de racheter Orangina, il saisit le ministère de l’Economie.
Ces marques les plus emblématiques du capitalisme et de l’american way of life se disputent les meilleurs marchés, les meilleurs comptoirs, les meilleurs corners, les meilleurs embouteilleurs, les meilleurs vendeurs.
Une lutte de chaque jour, orchestrée par des managers stars, pour le plus grand plaisir de leurs actionnaires. Car à Wall Street, la bagarre du rouge et du bleu, c’est de l’or ! »
Du soft drink au soft power… La mise en scène de cette histoire est résolument hollywoodienne. Chaque chapitre est titré du nom d’un film pour mettre le lecteur dans l’ambiance.
- Pulp Fiction
- Les Sentiers de la Gloire
- America, America
- Le Jour le plus Long
- La Bataille de France
- Star Wars – La Guerre des Etoiles
- L’histoire sans Fin
La mode et le marché ? La mode EST le marché
La Revue des Deux Mondes – Juillet 2001
« Je ne suis pas un artiste ! Moi, je suis cynique, je me demande si ça va vendre. Je peux et je veux vendre. Je suis une sorte d’artiste commercial, pas un créateur. »

En quatre phrases, dans une interview choc à L’Express, en mars 2001, Tom Ford a tombé le masque. Le styliste star de Gucci, l’homme qui a ressuscité la griffe italienne, moribonde au début des années quatre-vingt-dix et qu’il portera à l’avant-garde du « porno chic », le nouveau maître de la maison Yves Saint Laurent, a remis les pendules à l’heure, et la mode à sa place : celle du marché.
Aussitôt, les vestales de la Mode avec un grand M ont poussé de hauts cris. Elles avaient donc réchauffé un serpent en leur sein ! Ce Texan aux yeux de braise et à la mâchoire serrée n’était qu’un imposteur, un marchand parmi les marchands… Serge Weinberg, le patron de PPR, le groupe qui a racheté Gucci et Saint Laurent, a enfoncé le clou, dans Le Monde : « Tom Ford n’est ni un créateur classique ni un dirigeant classique. Il est un grand « entertainer ». Il contrôle l’image de Gucci de A à Z, avec une cohérence totale. »
Un entertainer ? Bigre… Cette fois, les marchands sont entrés dans le temple. Au cœur même du saint des saints : la création. La mode et le marché, désormais, sont intimement liés.
« Remplacer le besoin par l’envie », chantait Daniel Balavoine. Tel est le ressort intime de la mode et le moteur principal du marché.
L’envie ? Celle de posséder, bien sûr, mais pas n’importe quoi : le dernier cri, ce qui se fait, ce qui se voit, ce qui se porte, ce qui se lit, ce qui s’écoute, ce qui se goûte. Bref, ce qui est à la mode.
Cela vaut pour l’habillement comme pour l’ensemble de la sphère marchande. Les faiseurs de mode, tels des Messieurs Jourdain faisant de la prose, ont sans le savoir inventé les principes de l’industrie moderne. Il n’est plus une entreprise aujourd’hui, de l’automobile à l’alimentaire, de la banque à la distribution, qui ne parle de flux tendus, de production « tirée » (par la demande des clients), de capital-marque, de design des produits, de maîtrise de sa distribution…
« La nouveauté, c’est mon job », dit Tom Ford, remettant au goût du jour ce mot suranné, venu du fond des âges d’avant la société de consommation, de ce XIXe siècle qui vit naître les « magasins de nouveautés », ancêtres de nos grands magasins.
En somme, la mode est à la mode. Mais la Mode, la vraie, dans tout cela ? Tout en continuant à se la jouer « exception culturelle », elle a discrètement, comme par un échange de bons procédés, emprunté à la grande industrie ses méthodes. Qui sait qu’aujourd’hui l’un des industriels qui ouvre le plus d’usines en France s’appelle Louis Vuitton ?
Le grand Christian Dior lui-même, inventeur du « New Look », n’était-il pas, d’une certaine façon, le plus « cynique » des créateurs de mode lorsqu’il déclarait tranquillement : « Peu m’importe qu’on parle en bien ou en mal de Dior, du moment qu’on en parle. »
Jusqu’au début des années quatre-vingt, les créateurs semblaient vouloir résister à cette marchandisation de la mode. On se flattait de voir en eux avant tout des artistes. Les Italiens Gianni Versace ou Giorgio Armani avaient élu domicile à Hollywood, où ils habillaient les stars et partageaient leurs fêtes et leurs Follies. La France restait figée sur le mythe du « grand couturier ». Le petit monde de la mode était structuré comme une société de castes, fortement hiérarchisée.
L’essence précède l’existence
Tout au sommet de la pyramide trônait la Haute Couture, avec ses dieux, ses prêtres et ses icônes. Un petit cénacle très fermé d’une quinzaine de maisons, jalouses de leur statut. Un jeune créateur de vêtements ne pouvait qu’aspirer à cet Olympe ou déchoir. Le dernier admis s’appelle Jean-Paul Gaultier, en 2000. À 51 ans, il était temps… Le précédent fut Christian Lacroix, hissé au sommet par LVMH en 1987.
Pourtant, les années soixante, là comme ailleurs, avaient ouvert les fenêtres, fait entrer sous les projecteurs les « jeunes créateurs », les Courrèges, Rabanne, Lapidus, ravis de faire la nique aux couturiers établis… que devinrent certains d’entre eux. On leur concéda quelques vertus artistiques, mais ils étaient cantonnés à l’univers du prêt-à-porter.
Enfin, caste inférieure, venaient les marques et fabricants de prêt-à-porter. Certains se firent un nom, Hechter, Cacharel, mais de reconnaissance, point…
Puis vint Bernard Arnault.
Lorsqu’en 1985 cet inconnu du monde des affaires rachète le groupe Boussac, tout le monde s’interroge : que va donc faire ce jeune et brillant polytechnicien, pianiste à ses heures, dans les décombres de l’ancien empire textile ? L’homme a décelé une pépite dans le fatras d’usines et de sociétés reprises avec la bénédiction de l’État : Christian Dior.
Quoi ? Une maison de couture, en perte de vitesse et déficitaire ? Une danseuse, quoi…
Alors que les années fric battent leur plein, Bernard Arnault a senti le potentiel industriel et commercial, et surtout financier, que possédait déjà la mode, qu’il englobe dans une définition plus large : le luxe.
« Le luxe, c’est ce que l’on s’offre lorsqu’on n’en a pas les moyens ». Cette définition (apocryphe) du luxe va servir de ligne rouge à Bernard Arnault pour faire de LVMH le leader mondial.
Il a bien observé le monde de la grande consommation, où la toute-puissance des marques, mondiales de préférence, a permis de bâtir des empires. Coca-Cola, Levi’s, McDonald’s sont des icônes planétaires. Pourquoi pas Vuitton, Dior, Chanel ou Gucci ? D’autant que, dans le luxe, l’essence précède l’existence en quelque sorte : la notoriété est souvent déjà établie, il ne reste qu’à en exploiter les retombées. Là où Coca, Unilever et autres multinationales dépensent des milliards en publicité pour se construire une image, les marques de mode sont capables de s’installer dans l’imaginaire collectif d’un seul trait de génie, d’un seul coup de pub. Chanel a accédé au rang de marque universelle grâce à la petite phrase de Marilyn Monroe susurrant qu’elle dormait vêtue de son seul parfum, le N° 5…
L’échec relatif de Lacroix, resté une griffe confidentielle (en chiffre d’affaires sinon en notoriété), sera un acte fondateur en creux. Seule compte, désormais, la marque. Le créateur n’est qu’un paramètre parmi d’autres. Interchangeable au besoin.
Recruté chez Dior en 1996, le créateur anglais fantasque et totalement inconnu hors des cercles des fashion victims John Galliano remet, en quelques défilés chocs, la griffe mythique au centre des conversations, autant dire au centre du monde.
Sur scène, un styliste vedette, payé comme un avant-centre, dont le rôle est moins d’habiller les femmes que de marquer des buts médiatiques. Backstage, une armada de marketeurs et stylistes, prêts à transformer en beaux et bons produits les idées même les plus délirantes du maître. En aval, enfin, un réseau de boutiques exclusives, sous contrôle, gérées d’une main de fer, pour récupérer jusqu’au dernier centime de marge. La machine à cash tourne à plein régime. Le marché et la mode, désormais, ne font plus qu’un.
La pyramide n’a pas pour autant disparu. Elle est désormais mondiale. Au sommet, les grandes marques planétaires ou capables de le devenir, aristocrates ou roturières, de Hermès à Calvin Klein. Au centre, les marques de créateurs ou de prêt-à-porter de luxe, les Kenzo, Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier. Certaines peuvent aspirer à atteindre le sommet. En bas, toujours, le marais innombrable des petites marques de prêt-à-porter.
Mais une nouvelle catégorie a fait son apparition : les marques-enseignes, Zara, Mango, voire H&M. Des copieurs plus que des créateurs, qui menacent à la fois les antiques enseignes et les vraies marques de mode, pillées sans retenue.
La mode et le marché, décidément, n’ont pas fini leur pas de deux.
